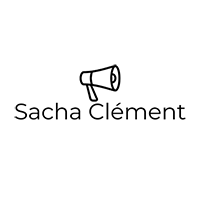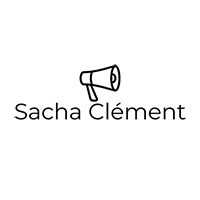L'histoire de mon premier marathon
Tous ceux qui l'ont fait le disent: les 7 derniers kilomètres d'un marathon sont un enfer.
Alors tu les crois, évidemment. Car ceux qui ont vécu, savent.
Mais à tel point, jamais tu ne peux t'en douter. Encore moins l'imaginer.
Les 7 derniers kilomètres, sont un calvaire.
Le Golgotha.
L'enfer sportif sur terre, pour peu que cela existe.
Mais avant d'y être, aux 7 ultimes kilomètres, déjà c'est coton. Élevé dans la soie ou pas, ton cerveau est patchwork, tu bricoles des esquisses de plans, histoire de penser à autre chose qu'à la structure de course que tu t'es cousue. Car tu y feras un zigzague, inévitablement.
Ton cerveau est patchwork, tu bricoles des esquisses de plans, histoire de penser à autre chose qu'à la structure de course que tu t'es cousue.
Au début du marathon, tu te pavanes.
Tu suis ton meneur d'allure pêle-mêle, le buste droit, fier comme un coq, tu regardes les spectateurs dans les yeux. Fier comme pas deux.
Beaucoup plus tard, tu ne les vois même plus, ces spectateurs. Tu vois à peine tes pieds. Certains courent alors pieds nus, les chaussures dans les mains, les ampoules aux pieds ont éclaté, le sang sur le parcours. Des yeux, tu ne cherches plus les spectateurs mais les panneaux des kilomètres en bord de route, ceux-là qui semblaient s'enchaîner au début à vitesse grand-V, kilomètre 8, 9, 10, ça allait si vite.
Tout allait bien, même les paysages défilaient, beaux.
Désormais les kilomètres n'arrivent plus qu'au compte-goutte.
37.
38.
39.
C'est si lent qu'ils semblent ne plus jamais arriver, ces panneaux indicateurs du mal. A tel point que tu te demandes si tu n'en as pas raté un. Ta vue est embrumée, chaque pas un écran de fumée, tu respires gras et tes rêves de chrono-miracle s'évaporent.
40.
41.
La ligne est encore si loin. Jamais 1,195 mètres n'auront été si longs.
Au début du marathon, dans ta tête tu gribouilles déjà le WhatsApp que tu vas faire à tes potes, genre: "c'est plus facile qu'ils le disent tous. Ils exagéraient la difficulté, moi j'ai eu du plaisir".
Au kilomètre 37, je téléphonais à ma maman pour qu'elle me réconforte.
Oui, en pleine course et en pleine disgrâce, j'ai lancé un coup de fil à ma maman.
Moi qui pensais Facebook, WhatsApp et Twitter, j'appelais ma mère.
Moi qui pensais Facebook, WhatsApp et Twitter, je téléphonais à ma mère, au kilomètre 37, pour qu'elle me réconforte.
Mais retour au kilomètre 10. C'est toujours la routine. Tu te demandes même si c'est déjà le moment d'accélérer, histoire de rejoindre le meneur d'allure qui est 15 minutes devant. Tu chopes le melon. Ou presque. Tu te dis que ça va aller. On va se le faire, ce marathon.
Kilomètre 18. Là tu commences à te demander ce que tu fais là. Pour une raison simple: la lassitude. Comme beaucoup, tu as l'habitude de faire des sorties de 60 minutes, voire 75. Là tu en es à 90 minutes, et si les jambes suivent, si le mental va, c'est le reste qui se met en branle. Les parties de ton corps que tu n'as pas l'habitude de solliciter.
En gros: le souffle est parfait.
Les jambes suivent.
Le mental est bon.
Mais le ventre, il ramasse. Le ventre, cet organe qui n'avait jamais dérangé dans une course.
Là tu apprends qu'il encaisse aussi, ton ventre.
tu penses faire un pet ou lâcher un gaz. Mais voilà que la diarrhée est là. Ton pas de course n'est plus aussi coulant ni fluide; ton short ramasse une traînée, toi tu commences à traîner.
Pour le soulager, tu penses faire un pet ou lâcher un gaz. Mais voilà que la diarrhée est là. Ton pas de course n'est plus aussi coulant ni fluide; ton short ramasse une traînée alors que toi, ô cruauté, tu commences à traîner. Alors tu t'arrêtes faire pipi. Ça passe.
Mais dans ton ventre ça remue toujours, dans ta tête aussi: tu te demandes si tu as mangé convenablement, aurait-il fallu sauter l'apéro de la veille? Ou la bière pendant le match de foot de la veille? Ou les mayonnaise sur sa plancha? Ou le dessert était-il de trop? Ai-je seulement bien déjeuné ce matin?
Tu te demandes.
Et si tu commences à douter, certaines questions trouvent réponse.
Maintenant tu comprends pourquoi dans les vestiaires avant la course, a 07:30, chacun est dans sa bulle, le regard sombre et la tête basse. Tu comprends pourquoi tout le monde ne pipe mot, la mine taciturne et la tonsure grise. Tu comprends ceux qui disent "plus jamais". Tu comprends les fameux 7 derniers kilomètres. Tu comprends pourquoi l'ambiance était si tendue dans ce vestiaire. Ce n'était pas la météo capricieuse. Ni l'effet du dimanche.
C'est que les gens savaient.
Car ceux qui ont vécu, savent.
Mais on fait fi.
On va se le faire, ce marathon.
Kilomètre 28. Toujours les problèmes gastriques. Voilà plusieurs kilomètres que mon ventre me joue des tours. Je le sens, j'ai la chiasse. Mais biologiquement, il m'est impossible d'aller à selle ailleurs qu'à la maison. Pourtant, je n'en peux plus.
Je quitte le parcours discrètement, m'affaisse derrière un buisson, je baisse mes culottes.
Mais je suis bloqué. Le sphincter a dit quoi? Rien. Il bloque.
Très vite les frottements deviennent irritation, qui vireront très vite au sang, si je ne change rien.
Les 3,000 mètres suivants sont insupportables. J'ai tellement mal au ventre que j'en sers les jambes. Afin d'éviter de me retrouver plein de merde, je sers les fesses très fort, donc les cuisses aussi, avec les problèmes y relatifs: très vite les frottements deviennent irritation, qui vireront très vite au sang, si je ne change rien.
Bref, je suis en train d'attraper le loup.
Mon entrejambe est en feu.
Mes fesses aussi.
Mon cerveau bouillonne: vais-je arriver au bout, de ce foutu calvaire?
Mais la délivrance arrive, en bord de route. Un portacabine de WC, pour les spectateurs de la course. Heureusement, l'un est libre. J'enfonce la porte. Avant de baisser mon short: je jette un œil: la lunette est immonde, guindée d'urine, les toilettes remplies d'excréments. Habituellement, je serais ressorti illico-presto (quoi que je n'y serais même pas entré). Oui, je ne vais à selle qu'à la maison.
Mais là, tout sort.
Pendant plusieurs minutes, je me vide.
Mais paradoxalement, je fais le plein d'énergie.
Mentalement, surtout.
Finies, les tracasseries gastriques.
Le meneur d'allure m'a semé pendant que je déféquais. Pour refaire mon retard, je fonce. 13 km/h de moyenne au kilomètre 30. Ce qui est bien. Trop bien. Car je vais trop vite.
Donc je repars, pied au plancher. Prêt à combler mon retard emmagasiné aux toilettes. Le meneur d'allure m'a semé pendant que je déféquais. Je fonce. 13 km/h de moyenne au kilomètre 30.
Ce qui est bien.
Trop bien.
Car je vais trop vite.
Je n'ai pas retenu la leçon. De ceux qui ont déjà couru un marathon, et qui savent: "ne te grille jamais, tu finis toujours par le payer".
Nonobstant ces conseils que j'avais tant écoutés, je me disais qu'il ne me restait que 12 kilomètres, soit une sortie habituelle, de celles que je fais 3-4 fois par semaine en plus de mes autres activités sportives (rameur, vélo, etc.).
12 kilomètres, soit la distance moyenne que je parcours chaque samedi ET dimanche matin à 06:15 du mat' depuis 12 mois - sans en rater une seule. Ces sorties matinales que je fais, assez facilement, parfois ivre, parfois mal réveillé.
Donc ça va aller.
12 kilomètres, à Genève, Pont du Mont-Blanc, du monde pour encourager.
Easy.
Facile.
Finger in the nose.
Surtout que je venais de chier.
Mais c'est là que l'enfer commence, que je vais vraiment commencer à la chier.
On approche le bord du lac.
Mais je n'arrive plus à courir normalement. Mes jambes me font tellement mal.
Au début de la course, chaque participant, pour moi, était un adversaire car oui, je suis un compétiteur.
Je voulais tous les taper.
Les fumer.
Faire un meilleur chrono qu'eux, même si je ne les connaissais pas. Même si je ne les reverrais jamais, tous ces coureurs. Mon esprit de compétiteur voulait les laisser scotché sur le bitume, leur montrer que j'étais le plus fort.
37 kilomètres plus loin, chaque participant est devenu un allié.
Je cherche une tape amicale au moment où je me fais doubler.
Je cherche un mot de motivation.
La compétition ne m'intéresse plus, nous sommes unis dans l'effort, dans la douleur, dans l'horreur des 7 derniers kilomètres. J'en donne aux autres, des tapes et dès encouragement. J'aide ceux qui souffrent encore plus que moi. Moi le compétiteur sportif qui aime battre les autres; ces coureurs sont tous devenus mes coéquipiers, comme au FC lorsque j'étais un fier capitaine.
Kilomètre 38. Pénible.
Kilomètre 39. Horrible.
Mes jambes ne se plient plus. Ça fait trop mal. Donc je cours les jambes droites. Comme un danseur étoile qui trotte sur scène, avant le grand saut. Plier une jambe c'est une pique dans la fesse, le mollet qui brûle et les ischios qui frétillent.
Donc je cours comme je peux.
Comme un bout de bois. Je suis raide comme une pique. Je ne regarde plus les spectateurs droit dans les yeux, mais je suis droit comme un i, un authentique piquet.
Et je pense à ma femme, mon fils. J'ai leur photo dans la main. Je pleure.
Et je pense à ma femme, mon fils. J'ai leur photo dans la main.
Je pleure.
Kilomètre 40.
Kilomètre 41.
Enfin j'y suis.
Soulagé comme jamais. Selon mon podomètre, j'en suis à 3:29:30.
Donc je suis heureux.
Mais je me dis, comme tant d'autres avant moi: "plus jamais".
Mais je suis fier.
Car dorénavant, je pourrai aussi parler des 7 derniers kilomètres.
Une heure plus tard, assis dans le train, seul l'odeur de mon short me rappelle à quel point c'était dur.
Et si personne ne s'assied à côté de moi tant mieux.
Je peux pleurer tout seul dans mon coin.
Une heure plus tard, j'ai déjà oublié à quel point c'était dur.
Mais diable qu'est-ce que c'était bien.
D'ailleurs, on recommence quand?